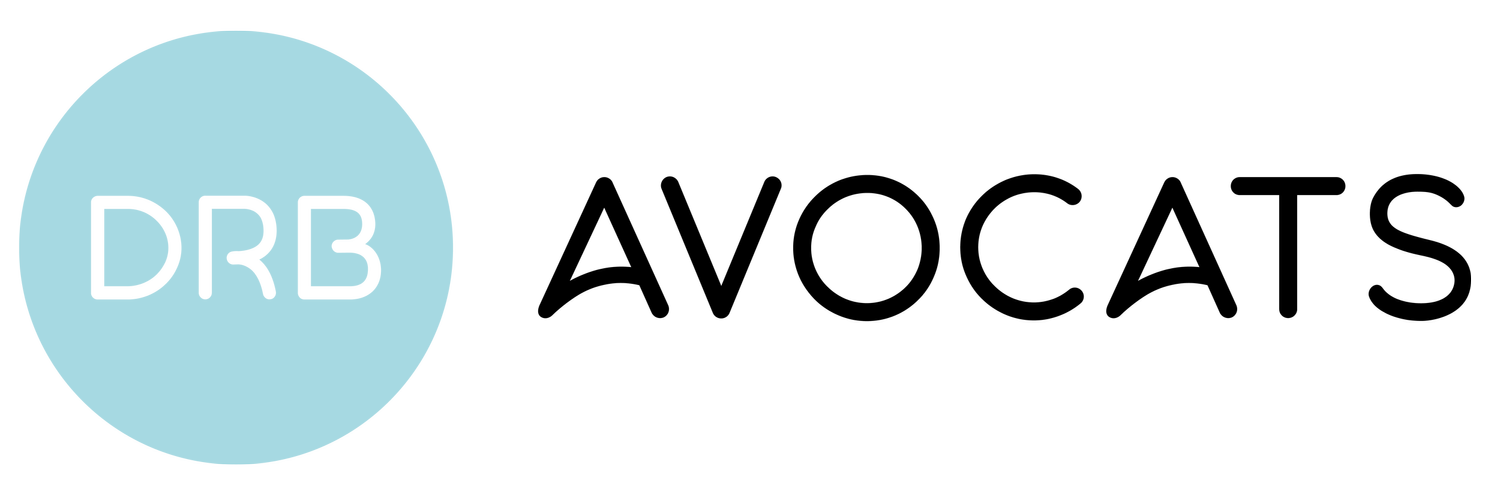Œuvres générées par IA : le droit d’auteur à l’épreuve de la machine
Le droit français opte pour une approche personnaliste du droit d’auteur : l’auteur est une personne physique (à quelques exceptions près : l’œuvre collective, l’œuvre de collaboration…) - Qu’en est-il des décisions rendues outre-atlantique?
Concernant le résultat (données « output ») généré par l’IA grâce au traitement des informations intégrées pendant la phase d’apprentissage, l’office de propriété intellectuelle des Etats-Unis (US Copyright Office) a par exemple refusé l’octroi d’une protection par le droit d’auteur sur une image générée par IA intitulée « A Recent Entrance to Paradise » au motif que l’œuvre n’a pas été conçue par un auteur humain ce qui constitue selon l’office une condition sine qua non à la délivrance d'un copyright (United States District Court, District of Columbia, Stephen Taller v. Shira Perlmutter, 18 août 2023).
De manière identique à la conception personnaliste du droit d’auteur français, la paternité humaine reste une exigence fondamentale du droit d’auteur. Ainsi, les juges français adopteraient en principe la même position que l’US Copyright Office dans le cadre d’une décision similaire.
Au regard des données initiales (données « input ») alimentant l’IA générative, celles-ci peuvent être protégées par le droit d’auteur, à condition d’être originales.
Si les données générées reproduisent les caractéristiques originales des données d’entraînement, même de façon partielle, elles ne pourront pas être utilisées sans l’autorisation préalable des auteurs de ces données.
C’est sur ce fondement que le 11 juin 2025, Disney et NBC Universal ont assigné le producteur d’IA générative Midjourney devant un tribunal fédéral de Los Angeles, en l’accusant d’avoir utilisé leurs contenus sans autorisation afin d’entraîner cette IA, notamment des images de Dark Vador ou des Minions, personnages créés par les deux studios.
Si l’originalité de ces personnages devra être démontrée, la décision attendue du tribunal s’annonce inédite, l’industrie du cinéma s’étant jusqu’ici tenue à l’écart de ce type de contentieux.
Ici encore, observer la jurisprudence américaine permettra d’esquisser les tendances que pourraient suivre, à terme, les tribunaux français.